L’équipe de direction permet aux chercheurs et chercheuses d’aller au bout de leurs ambitions. Elle accompagne l’Institut Courtois afin de laisser place à l’innovation, à la découverte et à la recherche libre.
Carlos Silva
Directeur
Directeur
Carlos Silva est professeur titulaire au Département de physique de l’Université de Montréal. Il est expert dans le domaine de spectroscopie ultrarapide et non linéaire des matériaux de pointe. De renommée mondiale, il est aussi devenu une référence incontestable en physique quantique. Il est en poste en tant que directeur de l’Institut Courtois depuis le 1 juillet 2023.
Titulaire d’un double baccalauréat en physique et en chimie, ainsi que d’un doctorat en physique chimique, Carlos Silva a une longue feuille de route. Au cours de sa carrière, il a été à l’emploi de nombreuses institutions universitaires. Il a été, entre autres, stagiaire postdoctoral Advanced Research Fellow à l’Université de Cambridge et professeur invité à l’Imperial College London, à l’Institut italien de technologie et à l’Université nationale autonome du Mexique. Professeur au Département de physique de l’UdeM de 2005 à 2018, il a obtenu une Chaire de Recherche du Canada en Matériaux Semiconducteurs Organiques et il a établi un laboratoire de spectroscopie laser ultrarapide. Il occupait, depuis 2017, le poste de professeur de l’Institut de technologie de Géorgie, où il a notamment été codirecteur du Center for Organic Photonics and Electronics (COPE), un centre de recherche regroupant des chercheurs et chercheuses des départements de chimie, de physique, de matériaux, de mathématiques et de génie électrique, chimique et mécanique.
Il a une vision ambitieuse pour l’Institut Courtois ou il compte établir une culture d’excellence collaborative et multidisciplinaire afin de garantir une production scientifique ambitieuse et à fort impact. Il souhaite d’ailleurs mobiliser les expertises des départements de physique, de chimie et d’informatique afin de générer de nouvelles connaissances d’impact. Il veut que l’Institut devienne un environnement propice à la réalisation des meilleures recherches mondiales dans un domaine qui est à l’intersection des nouveaux matériaux, de la physique quantique, de la robotique et de l’intelligence artificielle.
À titre de directeur de l’Institut Courtois, il compte établir des partenariats avec divers établissements canadiens et internationaux, en plus de promouvoir la recherche multidisciplinaire. «Je considère que l’Institut Courtois est un organisme transformateur qui nous permettra de nous hisser au sommet du milieu de la recherche canadienne. L’objectif sera de connaître une croissance ambitieuse mais crédible, afin d’atteindre les objectifs d’excellence que nous nous sommes fixés.»’, mentionne-t-il.
Au sein de l’Institut, Carlos Silva continuera ses recherches sur la spectroscopie optique cohérente sur des matériaux quantiques et photoniques.

Delphine Bouilly
Directrice adjointe
Directrice adjointe
Delphine Bouilly est engagée dans le développement de la bionanoélectronique, une approche émergente et interdisciplinaire qui vise à exploiter les propriétés électriques exceptionnelles des nanomatériaux pour détecter, sonder et comprendre les molécules qui forment le monde du vivant.
Dans son laboratoire, son équipe conçoit des circuits électroniques à partir de matériaux de basse dimensionnalité, comme les nanotubes de carbone (1D) ou le graphène (2D). Ces circuits leur permettent de mesurer, par le biais de fines fluctuations de courant électrique, les interactions subtiles entre ces matériaux et des molécules biologiques telles que l’ADN ou les protéines. Pour ce faire, Delphine Bouilly et son équipe développent de nouvelles méthodes misant sur la miniaturisation, l’automation et la mise à l’échelle, pour synthétiser, assembler, mesurer et modéliser les nanomatériaux dans des environnements aqueux complexes et des laboratoires-sur-puce compacts.



Delphine Picca
Technicienne en bureautique et administration
Technicienne en bureautique et administration
Delphine Picca détient un diplôme universitaire en gestion et possède plus de 10 ans d’expérience en administration.
Son parcours professionnel caractérisé par un engagement envers la qualité et l’efficacité, son sens de l’organisation et sa grande aisance avec les outils technologiques font d’elle un atout pour la gestion de l’Institut Courtois.
Suivant son intérêt pour le milieu universitaire et l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la science des matériaux, elle apprécie cette opportunité de contribuer à un environnement intellectuellement stimulant et de participer à la création et la diffusion de connaissances.


Nathalie Tang
Coordinatrice
Coordinatrice
Nathalie Tang détient un doctorat en chimie physique de l’Université de Montréal et cumule plus de 8 ans d’expérience en tant que scientifique et gestionnaire de projets dans un environnement de recherche universitaire. Elle a notamment géré des projets multidisciplinaires rassemblant des étudiants, des professeurs et des professionnels des domaines médicaux, de l’ingénierie, des sciences des matériaux. Au fil des ans, elle a développé une expertise de pointe sur la caractérisation des nanomatériaux et leur application dans le domaine biotechnologique. Suivant sa curiosité pour l’intelligence artificielle (IA), elle a occupé le poste de coordinatrice à la direction scientifique et aux initiatives stratégiques à Mila, l’Institut d’intelligence artificielle du Québec. En combinant ses aptitudes de scientifique, de coordinatrice de projet ainsi que ses connaissances du domaine de l’IA et des matériaux, elle est la personne tout indiquée pour appuyer la direction de l’Institut Courtois pour en faire un institut d’excellence et d’innovation pour la découverte de nouveaux matériaux à l’aide de l’automatisation et de l’IA.


Carlos Silva
Directeur
Directeur
Carlos Silva est professeur titulaire au Département de physique de l’Université de Montréal. Il est expert dans le domaine de spectroscopie ultrarapide et non linéaire des matériaux de pointe. De renommée mondiale, il est aussi devenu une référence incontestable en physique quantique. Il est en poste en tant que directeur de l’Institut Courtois depuis le 1 juillet 2023.
Titulaire d’un double baccalauréat en physique et en chimie, ainsi que d’un doctorat en physique chimique, Carlos Silva a une longue feuille de route. Au cours de sa carrière, il a été à l’emploi de nombreuses institutions universitaires. Il a été, entre autres, stagiaire postdoctoral Advanced Research Fellow à l’Université de Cambridge et professeur invité à l’Imperial College London, à l’Institut italien de technologie et à l’Université nationale autonome du Mexique. Professeur au Département de physique de l’UdeM de 2005 à 2018, il a obtenu une Chaire de Recherche du Canada en Matériaux Semiconducteurs Organiques et il a établi un laboratoire de spectroscopie laser ultrarapide. Il occupait, depuis 2017, le poste de professeur de l’Institut de technologie de Géorgie, où il a notamment été codirecteur du Center for Organic Photonics and Electronics (COPE), un centre de recherche regroupant des chercheurs et chercheuses des départements de chimie, de physique, de matériaux, de mathématiques et de génie électrique, chimique et mécanique.
Il a une vision ambitieuse pour l’Institut Courtois ou il compte établir une culture d’excellence collaborative et multidisciplinaire afin de garantir une production scientifique ambitieuse et à fort impact. Il souhaite d’ailleurs mobiliser les expertises des départements de physique, de chimie et d’informatique afin de générer de nouvelles connaissances d’impact. Il veut que l’Institut devienne un environnement propice à la réalisation des meilleures recherches mondiales dans un domaine qui est à l’intersection des nouveaux matériaux, de la physique quantique, de la robotique et de l’intelligence artificielle.
À titre de directeur de l’Institut Courtois, il compte établir des partenariats avec divers établissements canadiens et internationaux, en plus de promouvoir la recherche multidisciplinaire. «Je considère que l’Institut Courtois est un organisme transformateur qui nous permettra de nous hisser au sommet du milieu de la recherche canadienne. L’objectif sera de connaître une croissance ambitieuse mais crédible, afin d’atteindre les objectifs d’excellence que nous nous sommes fixés.»’, mentionne-t-il.
Au sein de l’Institut, Carlos Silva continuera ses recherches sur la spectroscopie optique cohérente sur des matériaux quantiques et photoniques.


Hlér Kristjánsson
Département d'informatique et de recherche opérationnelle


Mickaël Dollé
Créateur de batteries recyclables
Département de chimie
Cellulaires, ordinateurs portables, véhicules électriques : les batteries aux ions de lithium entrent dans un nombre croissant d’appareils d’usage courant. Le cycle de vie de ces batteries doit avoir la plus faible incidence possible sur l’environnement. Mickaël Dollé travaille à les rendre plus vertes. Il a déjà breveté une technique pour récupérer les matériaux de la cathode de ces batteries et en faire de nouveaux sans engendrer de déchets. Des batteries peuvent donc être produites maintenant en boucle fermée dans un concept d’économie circulaire.
Chimiste de formation, Mickaël Dollé s’intéresse plus généralement à l’écoconception, soit la production de batteries par une utilisation moindre d’énergie et le choix de matériaux plus verts. Un exemple ? Pour remplacer les matériaux à base de fluor qui nécessitent de recourir à des solvants toxiques et qui compliquent le recyclage, le chercheur propose d’exploiter de nouveaux polymères. En 2020, ses collègues et lui ont ainsi conçu une batterie fabriquée à base d’eau et de bois, un exploit qui a été désigné découverte scientifique de l’année par les lecteurs du magazine Québec Science.
Avant de se joindre au corps professoral de l’Université de Montréal en 2014, Mickaël Dollé a fait des études postdoctorales au Laboratoire national Lawrence-Berkeley et à l’Institut Max-Planck de recherche sur l’état solide à Stuttgart. Il a aussi été chercheur au Centre national de la recherche scientifique, en France.
Sa programmation de recherche de la Chaire Courtois vise le criblage à haut débit de verres et vitrocéramique par automatisation de la synthèse et de la caractérisation physico-chimique avec l’appui d’activités de simulation. Alors qu’il existe plusieurs outils pour prédire l’existence et les propriétés des matériaux cristallins, notamment pour les batteries, il n’existe pas d’outil équivalent pour les verres et vitrocéramiques. La base de données ainsi générée pourra être utilisée par les algorithmes d’apprentissage automatique, qui nous assistera dans la conception et l’élaboration rationnelles de matériaux de verres et de vitrocéramique à propriétés contrôlées et/ou de nouvelles phases.
La chimie du solide, la science des matériaux et l’électrochimie seront au cœur des activités, avec un intérêt marqué pour la compréhension de la relation élaboration (synthèse et mise en forme)/ (micro)structure/propriétés dans le but d’améliorer les matériaux existants ou d’en créer de nouveaux.
Les retombées ciblées sont la production de connaissances fondamentales relatives à la transition énergétique et l’exploration de concepts novateurs dans le but de concevoir de nouveaux matériaux pour les technologies de demain.



William Witczak-Krempa
Le théoricien quantique
Département de physique
William Witczak-Krempa s’intéresse aux matériaux qui, à très basse température, acquièrent des propriétés quantiques. Par exemple, certains deviennent supraconducteurs : ils perdent toute résistance électrique. En pratique, les supraconducteurs ont plusieurs caractéristiques intéressantes qui permettent le transport d’électricité sans perte et la fabrication d’aimants extrêmement puissants.
La basse température limite cependant la production à grande échelle. Serait-il possible de créer des matériaux quantiques à température plus élevée pour qu’ils soient plus accessibles pour l’être humain ? C’est ce que tente de comprendre l’équipe de William Witczak-Krempa en exploitant divers outils mathématiques et numériques, dont l’intelligence artificielle.
La compréhension de la matière à l’échelle quantique est essentielle, notamment pour la production d’une machine qui fait rêver physiciens et informaticiens : l’ordinateur quantique – un ordinateur dont la puissance de calcul dépasserait grandement celle de l’ordinateur actuel.
William Witczak-Krempa est arrivé à l’Université de Montréal après avoir réalisé deux postdoctorats : l’un à l’Institut Périmètre de Waterloo et l’autre à l’Université Harvard. Il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les transitions de phase quantiques. Il est aussi membre du Regroupement québécois sur les matériaux de pointe et du Centre de recherches mathématiques.



Déterminés à relever les défis les plus complexes de notre société, ils ont en commun ce désir d’accélérer le processus de découverte pour contribuer au développement de nouveaux matériaux.
Ahmad Hamdan
Département de physique
Ahmad Hamdan est professeur au Département de physique de l’université de Montréal depuis 2017. Il se spécialise dans la physique des plasmas, en mettant particulièrement l’accent sur ceux générés dans un milieu liquide. Les plasmas qu’il étudie présentent de nouvelles propriétés en termes de température (1000s K), pression (10s bar), densité d’espèces (1017-19 cm-3) et durée de vie (100s ns). Contrairement aux plasmas conventionnels, les plasmas-liquides représentent des procédés extrêmement efficaces et écologiques pour la production de nanomatériaux, entre autres applications.
La souplesse inhérente à ces procédés permet l’initiation et le maintien des plasmas dans divers liquides tels que l’eau, les hydrocarbures, les liquides cryogéniques, etc. De plus, l’utilisation d’électrodes aux compositions chimiques variées contribue à cette polyvalence. Ces approches ont abouti à la fabrication d’une vaste gamme de nanomatériaux, notamment des nanocomposites, des matériaux présentant de nouvelles phases cristallographiques, ainsi que des nanoalliages métalliques binaires et tertiaires.


Alejandro Hernandez-Garcia
Département d'informatique et de recherche opérationnelle
Alex Hernandez-Garcia est professeur adjoint à l’Université de Montréal au Département d’informatique et de recherche opérationnelle (DIRO) et à Mila (Institut québécois d’intelligence artificielle). Il a grandi à Madrid (Espagne) et a vécu à Berlin (Allemagne) pendant ses études doctorales, avant de s’installer à Montréal pour travailler avec Yoshua Bengio et David Rolnick en tant que chercheur postdoctoral. Ses intérêts de recherche sont interdisciplinaires et, après avoir travaillé à l’intersection de l’apprentissage automatique, des neurosciences et des sciences cognitives, il se concentre actuellement sur la recherche en apprentissage automatique pour des applications scientifiques visant à lutter contre la crise climatique et les défis de santé.
Par exemple, il travaille sur le développement de méthodes génératives, telles que les GFlowNets, et des algorithmes d’apprentissage actif pour la découverte de matériaux et de médicaments. En particulier, il recherche des méthodes d’apprentissage actif multi-fidélité, la génération de structures cristallines, la conception d’électrocatalyseurs ou l’échantillonnage de conformations moléculaires. En plus de ses recherches, il est un fervent défenseur de la science ouverte au sens large et essaie de contribuer à cet objectif en s’impliquant dans les discussions sur la manière de rendre la science plus inclusive, équitable, ouverte, reproductible, transparente et consciente de l’environnement.


Andrea Bianchi
Département de physique
Le groupe Bianchi utilise des méthodes de chimie du solide pour créer et essayer de comprendre de nouveaux supraconducteurs et aimants non conventionnels. Nos outils pour étudier ces systèmes comprennent des mesures thermodynamiques, ainsi que la diffusion des neutrons et la spectroscopie des muons.


Antonella Badia
Département de chimie
Antonella Badia s’intéresse aux assemblages moléculaires organisés en deux dimensions. En utilisant des ligands organiques se liant aux surfaces métalliques, son groupe de recherche produit des monocouches auto-assemblées redox-actives pour déclencher et moduler électrochimiquement des processus aux interfaces pour des technologies telles que les actionneurs, les capteurs et l’électronique moléculaire.


Audrey Laventure
Spécialiste des matériaux fonctionnels pour l’impression 3D
Département de chimie
Audrey Laventure est spécialiste de la chimie des matériaux, en particulier les matériaux dits « amorphes », un qualificatif à l’opposé de la passion qu’elle voue à sa discipline ! Ses travaux, à la jonction de la chimie et de la physique, explorent le domaine émergent de l’impression 3D. Elle étudie le comportement des matériaux en fabrication additive pour rendre les objets imprimés en 3D fonctionnels grâce à une compréhension avancée de l’organisation de la matière.
Qui dit impression 3D dit architectures complexes. Un des objectifs du programme de recherche d’Audrey Laventure et de son équipe est de procéder à une transition des architectures complexes mais passives à des architectures complexes et fonctionnelles.
Tout le travail d’Audrey Laventure consiste justement à comprendre comment moduler les propriétés des matériaux au moyen de l’assemblage moléculaire. Par sa grande capacité computationnelle, l’intelligence artificielle permet d’accélérer le criblage des conditions de mise en forme des matériaux qu’on peut utiliser en impression 3D pour leur donner des fonctionnalités nouvelles.
Après avoir obtenu un doctorat à l’Université de Montréal et fait un stage postdoctoral à l’Université de Calgary, Audrey Laventure est revenue en 2020 à son alma mater pour y fonder son laboratoire de recherche, où elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les matériaux polymères fonctionnels (niveau 2).


Bang Liu
Département d'informatique et de recherche opérationnelle
Bang Liu est fasciné par les subtilités de l’intelligence, à la fois naturelle et artificielle. Tout en explorant les principes de l’intelligence, il utilise également son expertise pour appliquer les techniques d’IA à divers domaines scientifiques et plus particulièrement à la science des matériaux.
Avec un engagement à créer des systèmes d’IA sécuritaires, contrôlables et interprétables, l’expertise de Bang en traitement du langage naturel et en apprentissage multimodal & incarné est essentielle. Il est ardemment passionné par l’utilisation du pouvoir transformateur de l’IA dans des domaines clés tels que la science des matériaux, la santé et la réalité virtuelle (RV). Cette approche interdisciplinaire vise à forger de nouvelles découvertes et solutions en fusionnant l’IA avec d’autres disciplines scientifiques.
En août 2020, Bang Liu a rejoint le Département d’informatique et de recherche opérationnelle (DIRO) de l’Université de Montréal en tant que professeur adjoint. Il joue un rôle actif au sein du laboratoire RALI, avec un accent sur la recherche en linguistique informatique. Il est également membre associé de Mila – Institut québécois d’intelligence artificielle et titulaire d’une Chaire CIFAR IA Canada. Le parcours académique de Bang a débuté avec un B.Engr. de l’Université des Sciences et Technologies de Chine (USTC) en 2013, suivi de diplômes de M.S. et de doctorat de l’Université de l’Alberta en 2015 et 2020, respectivement.
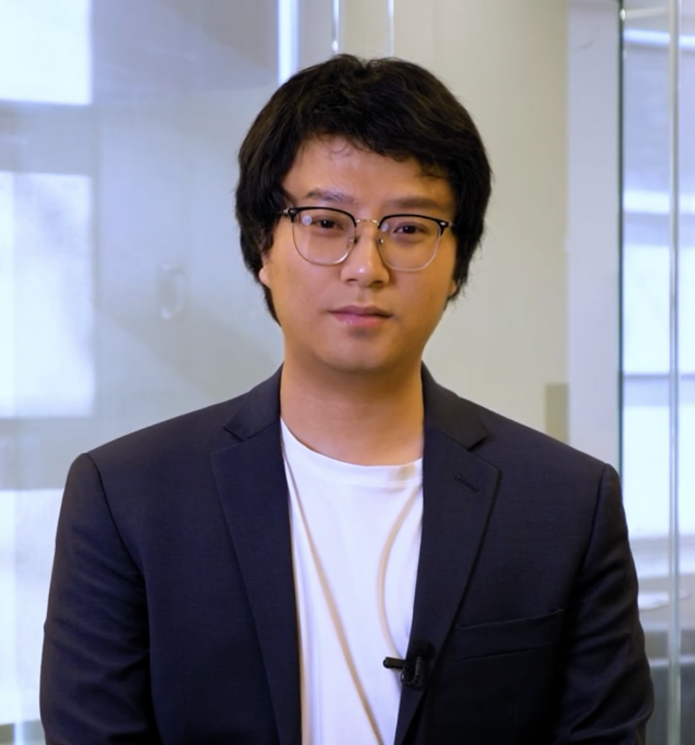
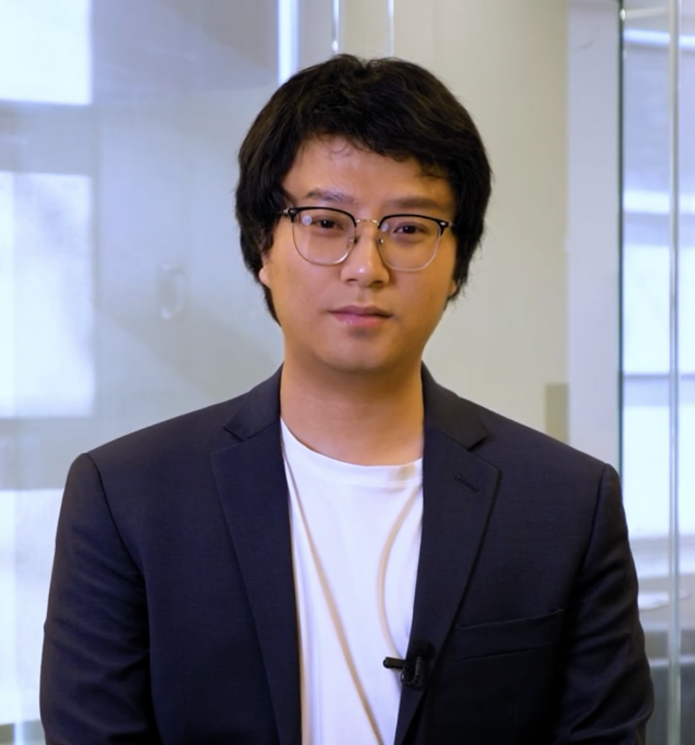
Christian Pellerin
Département de chimie
Les soies d’araignée, le nacre, les membranes cellulaires et les fibrilles des arbres sont des matériaux naturels dotés de propriétés exceptionnelles grâce à une combinaison d’ordre et désordre moléculaires. Les chimistes exploitent aussi l’ordre moléculaire pour concevoir des matériaux fonctionnels comme des gilets pare-balles et des dispositifs d’affichage.
C’est dans ce contexte que Christian Pellerin et son équipe fabriquent des matériaux moléculaires partiellement ordonnés et les étudient pour comprendre comment optimiser leurs performances. Leurs travaux portent sur les fibres électrofilées hautement orientées, sur l’ordre induit par la lumière dans les matériaux photoactifs, sur l’ordre dans les films ultraminces (avec Antonella Badia), ainsi que sur les matériaux moléculaires dits « amorphes » parce qu’ils résistent à l’ordre. Le groupe est spécialisé en caractérisation physicochimique des matériaux avec un accent particulier sur la spectroscopie vibrationnelle. Sur un plan plus appliqué, l’équipe Pellerin collabore avec des partenaires industriels et gouvernementaux pour mieux recycler les polymères et pour fabriquer des matériaux utiles à la sécurité nationale.
Après avoir complété un doctorat à l’Université Laval et un stage postdoctoral à l’Université du Delaware, Christian Pellerin s’est joint au Département de chimie de l’Université de Montréal en 2005 où il a fondé son laboratoire en spectroscopie des matériaux. Il est aussi le directeur de la plateforme instrumentale LCMP (Laboratoire de caractérisation des matériaux polymères).


Delphine Bouilly
Directrice adjointe
Directrice adjointe
Delphine Bouilly est engagée dans le développement de la bionanoélectronique, une approche émergente et interdisciplinaire qui vise à exploiter les propriétés électriques exceptionnelles des nanomatériaux pour détecter, sonder et comprendre les molécules qui forment le monde du vivant.
Dans son laboratoire, son équipe conçoit des circuits électroniques à partir de matériaux de basse dimensionnalité, comme les nanotubes de carbone (1D) ou le graphène (2D). Ces circuits leur permettent de mesurer, par le biais de fines fluctuations de courant électrique, les interactions subtiles entre ces matériaux et des molécules biologiques telles que l’ADN ou les protéines. Pour ce faire, Delphine Bouilly et son équipe développent de nouvelles méthodes misant sur la miniaturisation, l’automation et la mise à l’échelle, pour synthétiser, assembler, mesurer et modéliser les nanomatériaux dans des environnements aqueux complexes et des laboratoires-sur-puce compacts.



François Schiettekatte
Département de physique
François est professeur au département de physique de l’Université de Montréal depuis l’an 2000. Il est spécialiste de la synthèse et de la caractérisation des semi-conducteurs et des matériaux amorphes, en particulier par analyse par faisceau d’ions: en faisant rebondir des particules produites par un accélérateur, on peut identifier les atomes qui composent un échantillon et leur distribution en profondeur, à l’échelle du nanomètre. Cela est très utile pour savoir si les composés en couches minces synthétisés pour une large gamme d’applications allant de la micro-électronique aux revêtements résistants à l’usure pour les réacteurs d’avion ont les valeurs désirées. Depuis quelques années, il s’intéresse à la fabrication de miroirs à faible bruit, notamment dans le contexte des détecteurs d’ondes gravitationnelles (DOG). En effet, dans plusieurs systèmes d’ultra-haute précision comme les ordinateurs quantiques, les horloges atomiques, et les DOG, la sensibilité est limitée par le faite que les matériaux des miroirs peuvent se reconfigurer ou leurs propriétés autrement fluctuer, ce qui provoque du bruit. Son groupe cherche donc des matériaux minimisant ses phénomènes tout en respectant de nombreuses autres contraintes imposées par ces applications.


Gilles Brassard
Le père de l’informatique quantique
Département d’informatique et de recherche opérationnelle
Gilles Brassard est considéré comme le père de l’informatique quantique au Canada et l’un des pionniers de cette discipline dans le monde. En étroite collaboration avec le physicien Charles Bennett, il a créé un protocole qui jette les bases de la cryptographie quantique, clé de l’inviolabilité des communications. En collaboration avec cinq autres chercheurs, dont Charles Bennett mais aussi le Québécois Claude Crépeau, il a inventé le protocole théorique de la téléportation quantique en 1992, qui a été réalisé de façon expérimentale par d’autres chercheurs des années plus tard, ce qui a été sélectionné par la revue scientifique Science parmi les 10 exploits scientifiques les plus importants de 1998. Ces deux découvertes lui ont valu le prix Wolf de physique en 2018, conjointement avec Charles Bennett. Le professeur Brassard a été le premier Canadien à remporter ce prix en physique qui est souvent considéré comme l’antichambre du prix Nobel.
Les travaux de Gilles Brassard sont fondateurs en informatique quantique, un domaine émergent capable de produire des ordinateurs incomparablement plus puissants que le modèle classique grâce à l’exploitation des manifestations parfois déroutantes de la théorie quantique.
Né à Montréal, Gilles Brassard est passionné de mathématiques depuis son plus jeune âge. À 13 ans, il entre à l’Université de Montréal et entreprend un baccalauréat puis une maîtrise en informatique. Après avoir obtenu, en 1979, un doctorat en cryptographie à l’Université Cornell, il devient professeur à l’UdeM. Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en informatique quantique pendant 21 ans, il a fondé l’Institut transdisciplinaire d’information quantique et en est maintenant le directeur scientifique.


Glen Berseth
Coach de robots
Département d’informatique et de recherche opérationnelle
Aller au-delà de la machine qui apprend, avec l’aide de l’humain, à répéter sans cesse la même tâche : c’est ce qui intéresse Glen Berseth en matière d’intelligence artificielle. Il souhaite ainsi amener les robots à pouvoir apprendre par eux-mêmes dans le monde réel, en fonction de leurs expériences, pour régler des problèmes.
Il constate que les chercheurs et chercheuses de différents domaines ont maintenant à gérer toutes sortes d’opérations chimiques et de designs complexes qui ont besoin de boucles de rétroaction pour être testés et améliorés. Alors que ces éléments sont encore souvent évalués manuellement, Glen Berseth a l’ambition d’y apporter davantage d’intelligence artificielle pour accélérer le processus de développement afin d’arriver plus rapidement à de meilleurs résultats. Par exemple, pour fabriquer des produits chimiques ou de nouveaux matériaux qui peuvent avoir une foule d’utilités, comme permettre de construire des bâtiments plus verts à moindre coût ou produire plus efficacement de la nourriture.
Glen Berseth est arrivé à l’Université de Montréal à l’été 2021 et est devenu membre de Mila, l’Institut québécois d’intelligence artificielle. Auparavant, il avait effectué son postdoctorat au Berkeley Artificial Intelligence Research Lab.


Guillaume Rabusseau
Département d'informatique et de recherche opérationnelle
Guillaume Rabusseau est professeur agrégé au Département d’Informatique et de Recherche Opérationnelle de l’Université de Montréal, membre régulier du Mila et titulaire d’une chaire en IA Canada-CIFAR.
Ses recherches, au carrefour de l’apprentissage automatique, de l’informatique théorique et de l’algèbre multilinéaire, portent plus particulièrement sur les méthodes de tenseurs pour l’apprentissage automatique et sur la conception d’algorithmes d’apprentissage pour les données structurées en utilisant l’algèbre linéaire et multilinéaire.
Il s’intéresse notamment aux techniques de décomposition des tenseurs en utilisant des réseaux de tenseurs pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage quantique, les méthodes à noyaux, la théorie des automates (pondérés) et les grammaires probabilistes hors contexte, ainsi qu’aux modèles informatiques non linéaires sur les chaînes, les arbres et les graphes.


Hélène Lebel
Département de chimie
Le programme de recherche du groupe de la professeure Lebel porte sur le développement de nouvelles méthodologies de synthèse qui vise à mettre au point des procédés catalytiques et innovants notamment en utilisant la chimie en flux continu. De plus, son groupe s’intéresse à la synthèse et l’étude de nouveaux électrolytes organiques solubles dans l’eau pour les piles redox à flux.
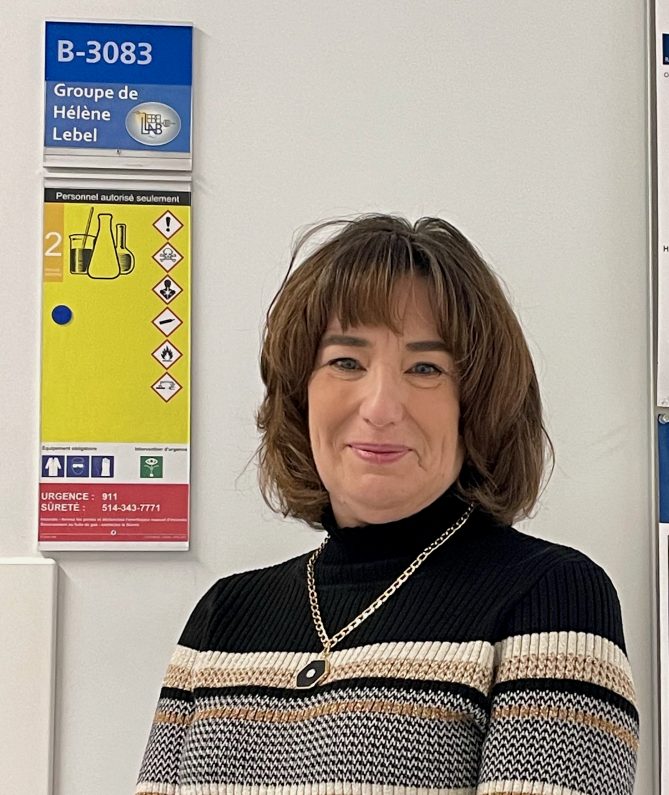
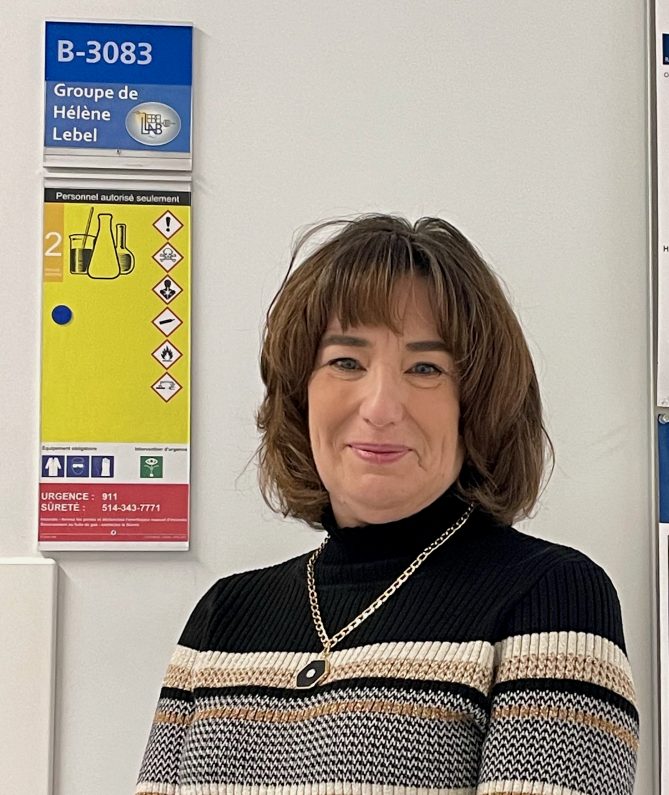
Houari Sahraoui
Département d'informatique et de recherche opérationnelle


James Wuest
L'organisateur de molécules
Département de chimie
L’organisation moléculaire : c’est le principal centre d’intérêt de James Wuest. Si l’on maîtrise l’organisation des molécules, on est alors en mesure d’en synthétiser de nouvelles afin de créer des matériaux aux propriétés inédites et prévisibles. Un immense avantage lorsqu’on veut élaborer des applications en sciences des matériaux !
C’est cette possibilité de concevoir les objets qu’il étudie qui a convaincu James Wuest de choisir la chimie organique lorsqu’il était jeune. Depuis, le professeur du Département de chimie de l’Université de Montréal mène des travaux internationalement reconnus qui touchent aussi bien à des aspects fondamentaux de la structure moléculaire qu’à des applications très pratiques. Des travaux qui profitent aujourd’hui des avancées de l’intelligence artificielle, notamment dans le domaine du génie cristallin.
Mais il y a des défis à relever parce que, contrairement à d’autres disciplines, les sciences des matériaux produisent peu de données. En même temps, à l’échelle moléculaire, les possibilités sont infinies. Il faudra imaginer des outils capables de fonctionner dans ce contexte. C’est cet univers de collaboration qui est particulièrement prometteur et stimulant pour le chercheur.
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les matériaux moléculaires, James Wuest a obtenu le prix Marie-Victorin en 2013, la plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec dans le secteur des sciences. Il a enseigné à l’Université Harvard, où il a obtenu son doctorat, avant d’accepter un poste à l’Université de Montréal en 1981.


Jean-François Masson
Département de chimie
Le groupe Masson développe de nouveaux nanomatériaux plasmoniques pour des applications en détection moléculaire, en catalyse et en conversion photothermale. Ils utilisent des méthodes spectroscopiques (Raman et plasmonique de surface) ainsi que des outils de microscopie optique et électronique pour caractériser les nanomatériaux. Ils développent de nouvelles méthodes de synthèse automatisée en boucle de rétroaction contrôlées par l’intelligence artificielle. Son groupe s’intéresse également à l’utilisation de l’intelligence artificielle pour extraire de l’information moléculaire par spectroscopie.
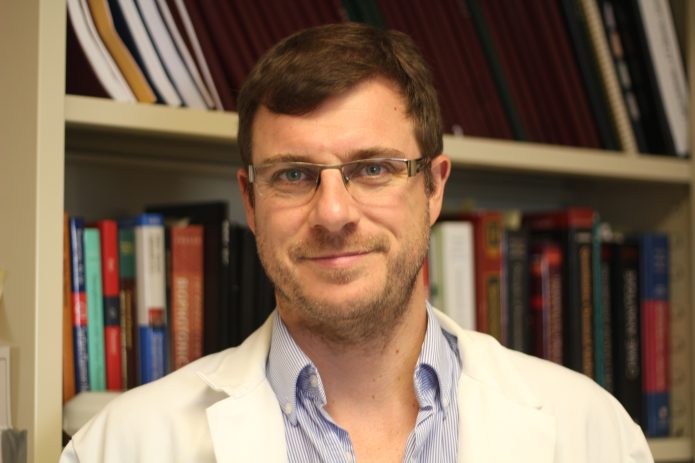
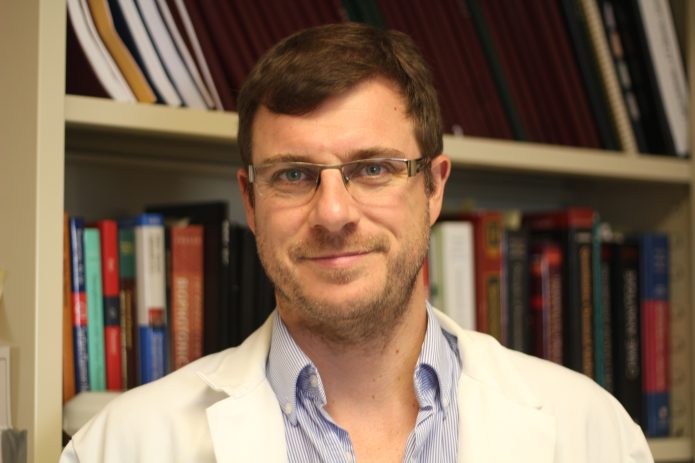
Kevin Wilkinson
Département de chimie
Notre groupe travaille dans le domaine de la nanotechnologie environnementale. Nos deux grands axes de recherche comprennent le devenir des nanomatériaux manufacturés dans les matrices environnementales et biologiques et la caractérisation des nanomatériaux et des nanoparticules dans ces mêmes matrices. Par ailleurs, du fait de notre besoin d’acquérir des données à une haute résolution temporelle (ms) et spatiale (quelques microns), nous sommes de plus en plus dépendants de technologies innovantes pour l’acquisition, le traitement, l’analyse et le partage de données massives, notamment grâce à des statistiques multiparamétriques (p. ex.: analyse des grappes, analyse des composantes principales) ou des nouvelles techniques basées sur l’intelligence artificielle.


Kirill Neklyudov
Département de mathématiques et de statistique


Liam Paull
Département d'informatique et de recherche opérationnelle
Liam Paull est professeur agrégé à l’Université de Montréal et co-directeur du Laboratoire de robotique et d’IA embarqué de Montréal (REAL). Son laboratoire se concentre sur les problèmes de robotique, notamment la création de représentations du monde, la modélisation de l’incertitude et la création de meilleures approches pour enseigner de nouvelles tâches aux agents robotiques (par exemple par simulation ou démonstration).


Luc Stafford
Spécialiste des plasmas
Département de physique
Manier des procédés basés sur les plasmas pour synthétiser ou ajouter de nouvelles fonctions aux matériaux. C’est l’expertise de Luc Stafford, professeur au Département de physique de l’UdeM.
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en science et applications des plasmas froids hautement réactifs, il s’intéresse aux propriétés exceptionnelles des plasmas pour mettre au point les matériaux et procédés de demain dans une perspective écoresponsable. En s’appuyant sur des connaissances fondamentales essentielles des plasmas et de leurs interactions avec la matière organique et inorganique, il cherche à obtenir un niveau de contrôle des matériaux et des procédés à l’échelle atomique, ce qui est important pour le développement de plusieurs nouvelles technologies, notamment celles dans le domaine quantique.
En 2020, ses collègues et lui ont conçu une nouvelle génération de batterie fabriquée à base d’eau et de bois, un exploit qui a été désigné découverte scientifique de l’année par les lecteurs du magazine Québec Science.
Luc Stafford est également conseiller spécial au Vice-rectorat à la recherche, à la découverte, à la création et à l’innovation de l’Université de Montréal. Il est responsable du laboratoire d’innovation Construire l’avenir durablement de l’Université, qui permet des rencontres multidisciplinaires pour réfléchir sur les enjeux de développement durable en recherche et en formation.


Luc Vinet
Département de physique
Les travaux de Professeur Vinet travaux portent en gros sur l’utilisation des symétries en théorie quantique sous deux volets soient 1) le design de chaines de spin aptes à réaliser le transport de qbits et la génération d’intrication ainsi que 2) l’étude de l’intrication de systèmes fermioniques sur des graphes à l’aide de méthodes associées à la combinatoire algébrique et au traitement du signal (en particulier celles développées pour résoudre les problèmes de limitation en temps et en fréquences).
Axes : Matériaux quantiques


Manu Paranjape
Département de physique
Manu Paranjape est un professeur au Département de physique et il étudie:


Michel Côté
Département de physique
L’expertise de mon groupe est dans le calcul de structure électronique à l’aide de méthodes comme la théorie de la fonctionnelle de la densité. Cette approche utilise la mécanique quantique pour calculer les propriétés des matériaux. Nos approches sont basées sur des principes premiers de la physique et ne requièrent donc pas de paramètres expérimentaux. Cela fait en sorte que nous sommes capables de prédire des propriétés de de nouveaux matériaux et ainsi explorer de nouvelles idées pour en déduire les pistes les plus prometteuses. Nos calculs sont aussi très prisés par nos collaborateurs expérimentateurs, car nous sommes en mesure de calculer les propriétés des systèmes qu’ils étudient sans biais théorique. Les membres de mon groupe sont des développeurs du code à source ouverte ABINIT qui implémente ces approches. Récemment, nos travaux nous ont amenés à l’utilisation de méthodes d’apprentissage automatique afin d’augmenter l’étendue des systèmes qui nous soient possibles de simuler. Les sujets qui nous intéressent sont les nanomatériaux, les supraconducteurs et les matériaux pour batterie.
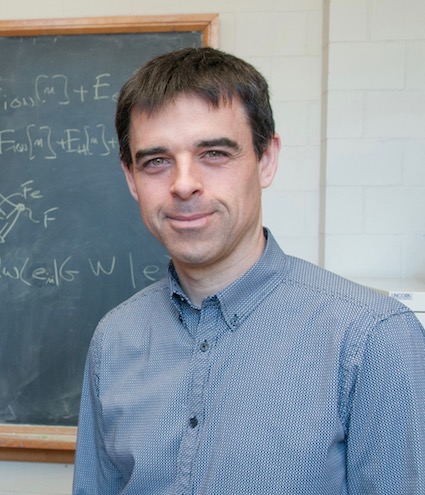
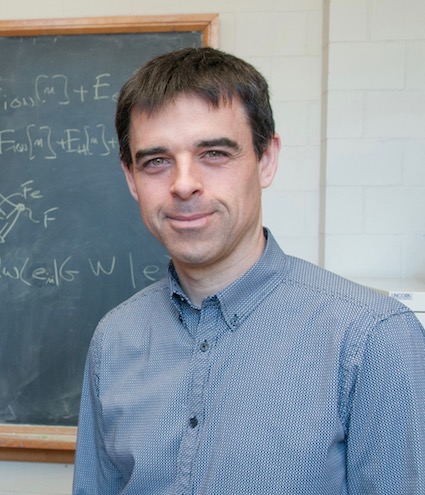
Mickaël Dollé
Créateur de batteries recyclables
Département de chimie
Cellulaires, ordinateurs portables, véhicules électriques : les batteries aux ions de lithium entrent dans un nombre croissant d’appareils d’usage courant. Le cycle de vie de ces batteries doit avoir la plus faible incidence possible sur l’environnement. Mickaël Dollé travaille à les rendre plus vertes. Il a déjà breveté une technique pour récupérer les matériaux de la cathode de ces batteries et en faire de nouveaux sans engendrer de déchets. Des batteries peuvent donc être produites maintenant en boucle fermée dans un concept d’économie circulaire.
Chimiste de formation, Mickaël Dollé s’intéresse plus généralement à l’écoconception, soit la production de batteries par une utilisation moindre d’énergie et le choix de matériaux plus verts. Un exemple ? Pour remplacer les matériaux à base de fluor qui nécessitent de recourir à des solvants toxiques et qui compliquent le recyclage, le chercheur propose d’exploiter de nouveaux polymères. En 2020, ses collègues et lui ont ainsi conçu une batterie fabriquée à base d’eau et de bois, un exploit qui a été désigné découverte scientifique de l’année par les lecteurs du magazine Québec Science.
Avant de se joindre au corps professoral de l’Université de Montréal en 2014, Mickaël Dollé a fait des études postdoctorales au Laboratoire national Lawrence-Berkeley et à l’Institut Max-Planck de recherche sur l’état solide à Stuttgart. Il a aussi été chercheur au Centre national de la recherche scientifique, en France.
Sa programmation de recherche de la Chaire Courtois vise le criblage à haut débit de verres et vitrocéramique par automatisation de la synthèse et de la caractérisation physico-chimique avec l’appui d’activités de simulation. Alors qu’il existe plusieurs outils pour prédire l’existence et les propriétés des matériaux cristallins, notamment pour les batteries, il n’existe pas d’outil équivalent pour les verres et vitrocéramiques. La base de données ainsi générée pourra être utilisée par les algorithmes d’apprentissage automatique, qui nous assistera dans la conception et l’élaboration rationnelles de matériaux de verres et de vitrocéramique à propriétés contrôlées et/ou de nouvelles phases.
La chimie du solide, la science des matériaux et l’électrochimie seront au cœur des activités, avec un intérêt marqué pour la compréhension de la relation élaboration (synthèse et mise en forme)/ (micro)structure/propriétés dans le but d’améliorer les matériaux existants ou d’en créer de nouveaux.
Les retombées ciblées sont la production de connaissances fondamentales relatives à la transition énergétique et l’exploration de concepts novateurs dans le but de concevoir de nouveaux matériaux pour les technologies de demain.



Normand Mousseau
Département de physique
Normand Mousseau est professeur au département de physique et il étudie la cinétique des matériaux complexes. Son groupe développe des algorithmes d’échantillonnage des surface d’énergie (Technique d’activation et de relaxation – ART nouveau) et des méthodes Monte Carlo cinétiques hors-réseau (ART cinétique).
Depuis 2005, il suit de près la question énergétique et des ressources naturelles. En plus de ses nombreuses interventions médiatiques, il a publié chez MultiMondes plusieurs livres sur le sujet dont « Au bout du pétrole, tout ce que vous devez savoir sur la crise énergétique», en 2008, et « La révolution des gaz de schiste », en 2010. Son dernier livre, « Le défi des ressources minières » est paru à l’automne 2012. En 2013, il a coprésidé la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec dont le rapport, « Maîtriser notre avenir énergétique, pour le bénéfice économique, environnemental et social de tous», a été rendu public à la fin février 2014.
Il est directeur scientifique de l’Institut l’énergie Trottier depuis 2016, il a contribué à la création de l’Institut canadien pour des choix climatique et de l’Accélérateur de transition. Il co-dirige également l’Initiative de modélisation énergétique.


Olivier Fontaine
Département de chimie
Comprendre les réactions électrochimiques au-delà des équations, en explorant la matière au cœur même de ses interfaces : c’est ce qui anime Olivier Fontaine. Spécialiste des électrolytes avancés, il cherche à concevoir des matériaux capables de mieux stocker et convertir l’énergie, dans un contexte de transition énergétique urgente. Pour lui, l’électrochimie est à la fois une science fondamentale et un outil au service de la société.
Formé à l’Université Paris Diderot, il affine sa vision au Collège de France en travaillant sur dans la chimie des nanomatériaux, puis à l’Université de St Andrews, sur les batteries. Il poursuit ses recherches au croisement des matériaux complexes et de l’électrochimie moléculaire, en se posant la question : Comment utiliser la chimie moléculaire et son électrochimie pour mieux comprendre les transferts d’électrons et ioniques dans les batteries ?


Philippe St-Jean
Le piégeur de lumière
Département de physique
Étudier l’interaction de la lumière et de la matière dans un régime quantique : voilà ce qui occupe Philippe St-Jean, titulaire d’une chaire de recherche du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec en photonique quantique.
Lorsqu’on allume une ampoule, des milliards d’électrons bougent dans toutes les directions et leur mouvement émet de la lumière. C’est le détail microscopique des mouvements d’électrons uniques, régi par la mécanique quantique, qui intéresse Philippe St-Jean. En plaçant des électrons uniques dans des cavités optiques, qui agissent comme des caisses de résonance pour la lumière, il est capable de circonscrire avec précision les modes photoniques auxquels ces électrons se couplent. Par exemple, il peut fabriquer des cavités où la lumière ne peut s’écouler que dans une seule direction ou reste piégée durant une longue période de temps.
En plus d’améliorer la compréhension des phénomènes complexes à l’échelle des électrons uniques, ses travaux permettront de fabriquer des sources de lumière quantique très robustes et précises, utiles notamment dans la cryptographie quantique. Les travaux de Philippe St-Jean peuvent aussi être transposés aux photons qu’on piège dans des réseaux de cavités pour simuler de nouveaux matériaux.
Philippe St-Jean a travaillé au Centre de nanosciences et de nanotechnologies du Centre national de la recherche scientifique et de l’Université Paris-Saclay. Il est devenu professeur au Département de physique de l’Université de Montréal à l’été 2021.


Richard Leonelli
Département de physique
Richard Leonelli est professeur titulaire au Département de physique, dont il a été directeur de 2013 à 2021. Spécialiste de spectroscopie optique des semi-conducteurs, il a publié plus de 100 articles touchant divers matériaux dont, en particulier, les hétérostructures à confinement quantique. Il est membre fondateur du Regroupement sur les matériaux de pointe et siège, à titre de représentant de l’Université de Montréal, au Comité-conseil du programme d’études préuniversitaires en sciences de la nature et à la Commission des études des certificats et de l’ingénieur de Polytechnique Montréal.


Richard Mackenzie
Département de physique
Richard MacKenzie est un chercheur en physique théorique avec un large éventail d’intérêts. La plupart de ses recherches sont axés sur l’étude de solitons topologiques et leurs applications dans plusieurs domaines de physique : la physique des particules, la cosmologie, la physique de la matière condensée et l’information quantique.
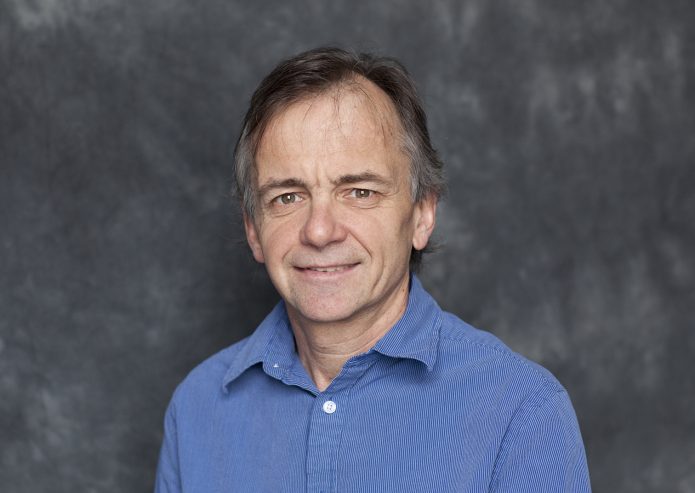
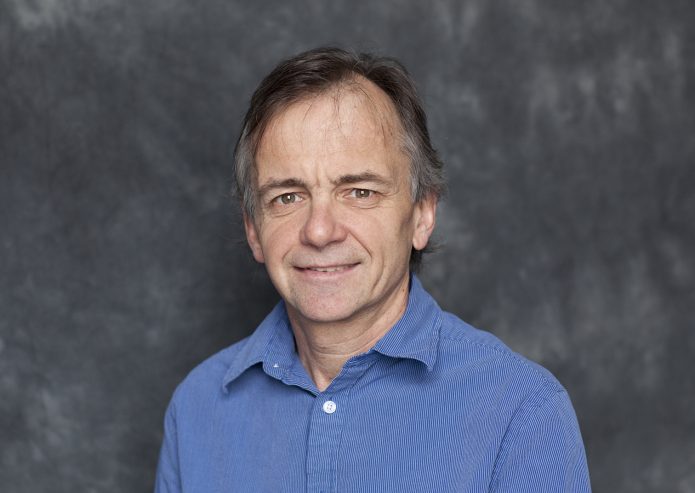
Richard Martel
Imager les vibrations
Département de chimie
Spécialiste des semi-conducteurs, Richard Martel a notamment contribué à la conception d’un microscope unique qui rend possible l’imagerie non seulement optique, mais également vibrationnelle. L’image hyperspectrale produite permet d’observer le spectre de chaque pixel grâce à des lasers de photons. Il travaille maintenant sur un équivalent avec des électrons pour obtenir une meilleure résolution – quasi atomique.
Ce type de spectromicroscopes fait partie d’une nouvelle génération d’instruments susceptibles de produire des quantités phénoménales de données spectroscopiques, mais leur analyse est lourde et complexe. Elle pourrait être améliorée par l’intelligence artificielle. Les retombées applicatives sont nombreuses, en particulier dans l’industrie de la microélectronique (production de lasers et de capteurs) et, plus généralement, dans la conception de capteurs qui utilisent les propriétés quantiques des électrons pour engendrer un signal.
Après un doctorat en science des surfaces à l’Université Laval, Richard Martel a pendant près d’une décennie fait de la recherche chez IBM, aux États-Unis, avant de devenir professeur de chimie à l’Université de Montréal. Il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les nanostructures et interfaces électriquement actives.


Simon Lacoste-Julien
Département d'informatique et de recherche opérationnelle


Suzanne Giasson
Département de chimie
Les recherches actuelles portent sur les phénomènes interfaciaux moléculaires, sur les interactions entre surfaces et sur la compréhension et l’utilisation des propriétés particulières des macromolécules (particulièrement des biomolécules et polymères) aux interfaces afin de concevoir de nouveaux matériaux dont les propriétés de surface peuvent être contrôlées spécifiquement, localement et réversiblement par des stimuli extérieurs. Les recherches visent des applications dans de nombreux domaines, notamment les capteurs et nano-actuateurs.


William Skene
Créateur de couleurs
Département de chimie
Lorsque vous regardez votre téléphone intelligent, vous voyez une foule de couleurs vibrantes. On n’y pense pas spontanément, mais beaucoup de travail est nécessaire pour arriver à ce résultat. C’est le domaine de recherche de William Skene. Lui et son équipe conçoivent les composés qui émettent la couleur déterminée par le design rationnel des molécules.
Mais son travail va au-delà de la couleur. Le chercheur tente aussi d’incorporer des propriétés pour rendre flexibles et étirables les composés qui sont utilisés pour construire des dispositifs électroniques organiques comme les téléphones intelligents. Ceux du futur pourraient ainsi devenir pliables, donc non cassables, grâce à ce type de recherches. Il essaie aussi de travailler de plus en plus avec des ressources renouvelables et en produisant le moins de déchets possible et pour améliorer le cycle de vie des dispositifs électroniques organiques.
William Skene est d’avis que, en collaborant étroitement avec d’autres collègues, en interdisciplinarité, les différentes étapes de la chaîne de fabrication des dispositifs pourront être réalisées, de la synthèse de la molécule à la fabrication à petite échelle, mais aussi à grande échelle. Le tout en conservant les mêmes propriétés.
C’est parce qu’il voulait comprendre comment les choses fonctionnent autour de lui que William Skene a choisi la chimie. Originaire de Winnipeg, il a fait ses études postdoctorales en France, à l’Université de Strasbourg (anciennement Université Louis Pasteur), avant d’être embauché par l’Université de Montréal en 2003.


William Witczak-Krempa
Le théoricien quantique
Département de physique
William Witczak-Krempa s’intéresse aux matériaux qui, à très basse température, acquièrent des propriétés quantiques. Par exemple, certains deviennent supraconducteurs : ils perdent toute résistance électrique. En pratique, les supraconducteurs ont plusieurs caractéristiques intéressantes qui permettent le transport d’électricité sans perte et la fabrication d’aimants extrêmement puissants.
La basse température limite cependant la production à grande échelle. Serait-il possible de créer des matériaux quantiques à température plus élevée pour qu’ils soient plus accessibles pour l’être humain ? C’est ce que tente de comprendre l’équipe de William Witczak-Krempa en exploitant divers outils mathématiques et numériques, dont l’intelligence artificielle.
La compréhension de la matière à l’échelle quantique est essentielle, notamment pour la production d’une machine qui fait rêver physiciens et informaticiens : l’ordinateur quantique – un ordinateur dont la puissance de calcul dépasserait grandement celle de l’ordinateur actuel.
William Witczak-Krempa est arrivé à l’Université de Montréal après avoir réalisé deux postdoctorats : l’un à l’Institut Périmètre de Waterloo et l’autre à l’Université Harvard. Il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les transitions de phase quantiques. Il est aussi membre du Regroupement québécois sur les matériaux de pointe et du Centre de recherches mathématiques.



Xavier Banquy
Département de chimie
Pr. Banquy est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en matériaux et interfaces bioinspirés. Ses domaines de recherche englobent l’étude des fluides (électrolytes) et de la matière molle (polymères) en confinement. Ces dernières années, son équipe a élucidé le mécanisme moléculaire de la superlubrification dans les solutions électrolytiques (appelé mécanisme de lubrification par hydratation) et exploré de nouvelles voies pour concevoir des matériaux superlubrifiants. Les travaux en cours consistent à étudier le comportement des solutions (poly)électrolytiques aux interfaces électrifiées en confinement extrême.


Yoshua Bengio
Le Nobel de l’informatique
Département d’informatique et de recherche opérationnelle
Sommité mondiale en intelligence artificielle (IA), Yoshua Bengio est un pionnier en apprentissage profond. C’est ce qui lui a valu en 2018 le prix A. M. Turing, considéré comme le prix Nobel de l’informatique, avec ses collègues Geoffrey Hinton et Yann LeCun.
Qu’est-ce que l’apprentissage profond ? C’est une branche de l’intelligence artificielle qui exploite les réseaux neuronaux de l’informatique pour créer de nouvelles générations d’algorithmes capables d’aider les ordinateurs à apprendre par eux-mêmes et où l’information est transformée à travers une séquence d’opérations inspirées du fonctionnement du cerveau, lesquelles correspondent à de nombreuses couches neuronales formant un réseau profond. D’où le nom d’apprentissage profond.
Aujourd’hui, les réseaux neuronaux sont au cœur de la plupart des avancées dans des domaines aussi variés que le traitement des langues naturelles, la traduction automatisée, la modélisation de la structure des protéines, la reconnaissance vocale et la reconnaissance faciale, la robotique, les véhicules autonomes, l’analyse d’images médicales, la découverte de médicaments, les simulations météorologiques ou encore la gestion des pannes et de la circulation automobile.
Si Montréal est devenue une plaque tournante de la recherche en intelligence artificielle, c’est beaucoup grâce à Yoshua Bengio. Fondateur et directeur scientifique de Mila, l’Institut québécois d’intelligence artificielle, Yoshua Bengio est également directeur scientifique d’IVADO, l’Institut de valorisation des données. Deux fleurons de l’IA autour desquels s’est constitué ces dernières années, en périphérie du campus MIL, tout un écosystème scientifique riche de plus de 1000 chercheurs et chercheuses.
Préoccupé par les retombées sociales de son travail et de celui de ses collègues, Yoshua Bengio a activement contribué à la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle et codirigé le groupe de travail du partenariat mondial sur l’intelligence artificielle pour l’IA responsable.

